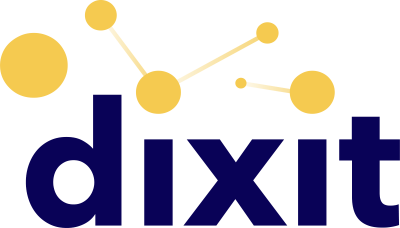La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2023 | Semaine 19Cette semaine à la Gazette, deux articles sur le thème de l’énergie :
Bonne lecture et bonne reprise ! |
|
Sommaire |
|
Notre sélection de la semaineQuestions émissions |
|
Notre sélection de la semaine |
|
Accélérer la construction de nouvelles installations nucléairesProjet porté par Mme Agnès PANNIER-RUNACHER Le projet de loi « relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes » vise en particulier les nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2. Il facilite les procédures administratives pour gagner du temps sur ces projets de réacteurs, prévus sur des sites nucléaires existants.
La France est aujourd’hui le pays le plus nucléarisé du monde, en proportion de sa population, avec 58 réacteurs répartis sur 19 sites. L’énergie nucléaire représente 72 % de l’électricité produite. Mais ses 56 réacteurs, construits entre les années 1970 et 1990, devaient a priori être progressivement mis à l’arrêt d’ici à 2050. Dans son discours du 10 février 2022 à Belfort, le président de la République a annoncé le projet de construction de 6, voire 14 nouveaux réacteurs de type EPR2. Selon le programme élaboré par EDF, la première paire pourrait voir le jour à Penly (Seine-Maritime), la deuxième à Gravelines (Nord) et la troisième dans le Bugey (Ain) ou le Tricastin (Drôme) – à proximité de centrales existantes. Deux éléments montrent la volonté gouvernementale et parlementaire d’aller vite.
Accélération de la construction de réacteurs EPR2Pour réduire les délais de construction de nouveaux réacteurs EPR2 à proximité des centrales actuelles, le texte prévoit les dispositions suivantes :
Prolongement des installations nucléaires actuellesIl est prévu à cet égard :
En première lecture, les députés ont confirmé plusieurs mesures votées par le Sénat, visant notamment à une meilleure information des départements et régions sur l’impact des nouvelles installations, l’accélération des résolutions de contentieux procéduraux, l’aggravation des sanctions en cas d’intrusion. Des rapports relatifs à l’impact de la relance du nucléaire, aux besoins en formation et en compétences et enfin sur les choix technologiques. Une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat est instaurée en faveur de la transparence démocratique. La fusion entre l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été écartée7. Le positionnement du Shift Project / des Shifters sur le nucléaireDans sa note _L’évaluation énergie-climat du PTEF, The Shift Project rappelle la nécessité de recenser les besoins en énergie de la France pour définir le mix énergétique (l’ensemble des infrastructures énergétiques transformant l’énergie primaire en énergie finale) qui permettra de répondre à ces besoins en assurant les transformations de l’industrie de l’énergie requises par la question climatique. À cet égard, la planification la plus volontariste de déploiement du nucléaire français, élaborée par RTE dans son rapport Futurs énergétiques 2050, aboutit en 2050 à une capacité d’environ 50 GW installés pour 325 TWh produits soit un taux de charge de l’ordre de 74 %8. Elle s’appuie notamment sur l’hypothèse de pousser la majorité du parc actuel jusqu’à une durée de fonctionnement de 60 ans9. « … l’industrie électronucléaire française sera au mieux capable de produire une paire de réacteurs de type EPR tous les deux ans à partir de 2035 […]. Cela correspondrait à mettre en service au maximum 14 EPR2 entre 2035 et 2050, dont la majorité entre 2040 et 20509.» Le mix électrique est lui aussi une clé de la décarbonation. En France, il est dominé par le nucléaire à environ 70 %, pilotable et stable, tandis que les autres sources bas carbone l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire principalement sont moins régulières. Selon RTE toujours, le déploiement du nucléaire est tributaire du « maintien sur plusieurs décennies de chaînes logistiques assurant l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la construction.9» Or nombre de pays réaliseront des déploiements analogues induisant ainsi des « risques de ruptures plus ou moins temporaires d’approvisionnement.9». Une attention particulière doit donc être portée à la diversification et au stockage préventif de nos approvisionnements en combustible. Enfin, The Shift Project rappelle l’importance des efforts de sobriété/efficacité pour réduire ces risques. Il inscrit le développement du nucléaire dans la perspective que « la consommation d’énergie de nos sociétés [soit] contenue, et décarbonée en substituant prioritairement des sources bas carbone aux sources d’énergies fossiles.10» La baisse de la quantité totale d’énergie doit passer notamment par l’évolution des comportements et l’organisation en conséquence de la société ainsi que par l’augmentation de l’efficacité énergétique. L’accélération du déploiement du nouveau nucléaire et la prolongation du nucléaire existant sont cohérentes avec l’accélération du déploiement des ENR (dans lequel la France est largement en retard par rapport aux autres pays européens) et avec une politique de sobriété et d’efficacité énergétique11. Le dimensionnement de ces mesures doit cependant découler d’une confrontation entre l’évaluation des besoins énergétiques au cours de la transformation de l’économie et le mix énergétique envisageable. En cherchant à minimiser les risques, The Shift Project conclut à un besoin immédiat d’organisation collective de la sobriété afin que chacun puisse conserver son bien-être et ses libertés tout en consommant moins, et ce même si l’ensemble des décisions politiques en faveur du nucléaire, des renouvelables (électriques ou non) et de l’efficacité énergétique sont prises dès aujourd’hui. Analyse critique du projet de loiParmi les mesures de simplification, la dispense de permis de construire ou l’accélération des expropriations nuira-t-elle à la future sûreté ou à la bonne acceptabilité locale des nouveaux réacteurs ? Certes, elles paraissent assez cohérentes avec celles retenues en parallèle pour un déploiement accéléré des énergies renouvelables. La priorisation des sites nucléaires existants permet aussi habilement de limiter les problématiques d’acceptabilité des nouveaux réacteurs et le Parlement a insisté sur les procédures d’information. Il n’en reste pas moins que la sensibilité des populations aux risques du nucléaire doit conduire à maintenir des entités garantes de la communication et des contrôles. 1 www.vie-publique.fr/loi/286979-relance-du-nucleaire-projet-de-loi-construction-nouveaux-reacteurs 2 gazetteducarbone.org/2023/04/11/la-gazette-du-carbone-semaine-15-11-avril-2023 3 gazetteducarbone.org/2022/12/13/la-gazette-du-carbone-semaine-50-13-decembre-2022 5 Les députés ont ajouté une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) aux réacteurs nucléaires, sous certaines conditions de puissance encadrées par décret (mesure envisagée par le Gouvernement puis retirée à la suite d’un avis du Conseil d’État). 6 gazetteducarbone.org/2023/05/02/la-gazette-du-carbone-semaine-18-02-mai-2023 7 gazetteducarbone.org/2023/04/25/la-gazette-du-carbone-semaine-17-25-avril-2023 8 Par rapport à une production théorique maximale de 50 GW x 365 j x 24 h = 438 TWh 9 Le total électrique produit serait de 645 TWh ENR et 325 TWh nucléaire (RTE 2021). RTE. Futurs énergétiques 2050 – www.rtefrance.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futursenergetiques#Lesdocuments. 10 www.theshifters.org/association/faq-shift-shifters/ 11 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Liens utiles : |
Questions émissions |
|
Les garanties d’origine biométhane doivent-elles être étendues aux installations non raccordées aux réseaux de gaz ?Portée par M. Mickaël Cosson - Côtes-d'Armor (1ère circonscription) M. Cosson a appelé le 7 mars 2023 l’attention de la ministre de la Transition énergétique sur le rejet, en commission mixte paritaire, dans le cadre du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, d’un amendement prévoyant l’extension des garanties d’origines au biométhane non injecté. Ce rejet constitue selon lui un frein au développement du biométhane1. Un peu de contexteLe marché du biométhane, en plein développement depuis une quinzaine d’années, représente 1400 sites de méthanisation en France en 20222. La production en gaz de ces sites peut être :
Dans les deux derniers cas, le raccordement au réseau et l’injection de la production ne sont pas nécessaires. Les garanties d’origine sont délivrées par les distributeurs aux entreprises ayant souscrit un abonnement qui comprend une part de biogaz et qui ont besoin de la justifier dans le cadre de leur bilan carbone. Cette garantie est purement contractuelle : dans les faits, le biogaz en question n’a pas nécessairement été consommé par cette entreprise, mais ailleurs sur le réseau, au plus près de son lieu de production. Ce qui compte, c’est que la somme des garanties délivrées soit égale au volume effectivement injecté dans le réseau (1 garantie d’origine = 1 MWh de biométhane injecté). C’est le principe de Mass Balance (utilisé également dans le réseau électrique) : on ne vend pas plus de biogaz que ce qui est injecté dans le réseau mais le produit physique délivré n’est pas forcément du biogaz6. Les garanties d’origine sont financièrement avantageuses pour les distributeurs ou les producteurs car les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour du biométhane leur permettant de remplir leurs objectifs de décarbonation. Le système est proche de l’ETS (European Trading System) décrit dans un précédent numéro de la Gazette Europe, ou encore des certificats verts d’énergie renouvelable. Les entreprises consommatrices d’énergie doivent en acheter une certaine quantité et les remettre à l’État pour certifier la neutralité carbone de leur production énergétique. Les distributeurs et producteurs de biogaz non raccordés au réseau général sont exclus de fait de ce mécanisme ; ils doivent donc vendre leur gaz vert physiquement, ce qui engendre des surcoûts rédhibitoires si le marché n’est pas à proximité immédiate de l’installation. Les entreprises raccordées peuvent en revanche vendre du gaz vert sur tout le territoire avec les coûts d’un réseau fossile. Cet état de fait créé un marché à deux vitesses entre les producteurs et distributeurs raccordés au réseau et bénéficiant des garanties d’origine et les autres. L’extension des garanties d’origine biométhane pose problèmeOn peut cependant douter de l’intérêt de raccorder toutes les installations de méthanisation, notamment celles qui sont loin du réseau général : l’investissement financier, l’empreinte carbone du raccordement, la pollution, les fuites de méthane parfois sous-estimées et dont l’effet de serre à court terme équivaut à 84 fois celui du CO2 sont très dissuasifs. Il semblerait en revanche judicieux de permettre de rémunérer le biogaz non injecté au même niveau que le biogaz, et faciliter son utilisation dans des débouchés de proximité (machines agricoles ou usines) . Faut-il alors étendre les garanties d’origine aux installations non raccordées ? L’objectif premier du système est de permettre d’identifier les ressources vertes dans le pool commun des ressources totalement fongibles de gaz apportées par le réseau. L’extension des garanties d’origine aux ressources non connectées aboutirait à une double comptabilité de ressources vertes, à la fois pour le biométhane utilisé localement et pour du gaz fossile injecté dans le réseau et bénéficiant indûment des garanties d’origine. Enfin, le biométhane non-injecté dans le réseau bénéficie de mesures, qui ont été retenues en commission mixte paritaire pour rejeter l’amendement d’extension des garanties d’origine. Il s’agit notamment d’un complément de rémunération quasiment équivalent à celui des garanties d’origine. La rareté du biogaz devrait plutôt inciter à mieux cibler ses usagesFrance Stratégie estime que la biomasse actuellement mobilisée (rapport de 20217) pour des usages énergétiques représente 40 TWh et que le potentiel maximal de la biomasse en France est de 120 TWh. Ces chiffres sont au demeurant très en deçà du potentiel énoncé dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), soit 250 TWh. Le Plan de transformation de l’économie française (PTEF) du Shift Project estime pour sa part que le gaz issu de l’agriculture continuera d’être consommé en 2050, en quantité 5 fois moindre que le gaz naturel actuellement (472 TWh en 2021). Cela représente tout de même plusieurs milliers d’installations qui devront soit injecter soit consommer localement le gaz produit. Le PTEF appelle cependant à fixer une limite claire à l’exploitation de la biomasse à des fins énergétiques. Il préconise même par prudence de ne dédier aucune surface agricole et aucune nouvelle surface forestière à cette production. Il est donc important de développer la filière biogaz de manière contrôlée. Les incitations à la production de biométhane doivent en tenir compte, peut-être en réservant le biométhane à des usages d’utilité publique où une énergie concentrée est nécessaire – transport lourd, industrie, agriculture, etc – et en équilibrant les garanties d’origine par des garanties d’utilisation. 1 www.assemblee-nationale.fr/dyn/deputes/PA793520/questions 2 www.grdf.fr/institutionnel/actualite/dossiers/biomethane-biogaz/unites-injection-gaz-vert 3 Il y a principalement deux réseaux en France: GRTgaz, et TIGF (Sud-Ouest) 4 www.methafrance.fr/en-chiffres 6 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045532120 Liens utiles : |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |