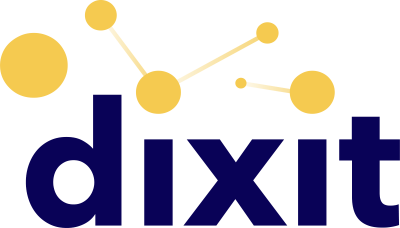La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2023 | Semaine 39Chères lectrices, chers lecteurs, Au lendemain des annonces gouvernementales sur la planification écologique, la Gazette du Carbone poursuit ses investigations dans sur des sujets toujours très diversifiés :
Faut-il y rechercher un point commun ? Sans doute pas, si ce n’est peut-être le trait de Spinoza dans son Traité Politique « Ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre ». Bonne lecture |
|
Sommaire |
|
Nos dernières actionsQuestions émissions |
|
Nos dernières actions |
|
Comment les institutions financières évaluent les risques climatiquesRéflexions décarbonées L’approche des risques climatiques par les institutions financières constitue à l’évidence un élément clé de la transition énergétique eu égard à leur rôle dans l’octroi des crédits aux entreprises et aux ménages, que ce soit pour défavoriser des activités polluantes ou favoriser des projets vertueux en matière de décarbonation. Les actions en cours sur ces sujets forts techniques mais déterminants méritent quelques clarifications. La publication par l’UNEP FI (United Nations Environment Program ou PNUE en français/ Finance initiative) d’un nouveau rapport en 20231 en fournit l’occasion. Il fait suite à ses deux premiers rapports de 2021 et 2022, pour présenter les évolutions des solutions proposées aux institutions financières pour les assister dans la mise en œuvre de leur stratégie d’analyse des risques climatiques. Fondée en 1992, l’initiative financière du PNUE rassemble un vaste réseau de plus de 500 banques, assureurs et investisseurs qui travaillent pour engager le secteur financier sur la voie de la durabilité. Il a par exemple été à l’origine des_ Principes pour l’investissement responsable2 _en 2004, aujourd’hui le principal promoteur mondial de l’investissement responsable. Une approche d’abord réglementaire…Le rapport commence par rappeler (dans sa section 1) l’engagement pris par de nombreuses institutions financières lors de la COP26 d’atteindre zéro émission nette à l’horizon 2050, ainsi que les évolutions réglementaires au sein de l’UE pour s’aligner sur cet objectif. Les tests de résilience au changement climatique se sont notamment répandus dans le secteur financier. L’existence de scénarios climatiques constitue à l’évidence un préalable à ces tests, d’où un besoin croissant des institutions financières d’outils permettant de les élaborer et de les analyser. Rappelons qu’en Europe, la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) qui encadre les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes sera remplacée à partir de 2024 par une nouvelle directive, plus ambitieuse, 2022/24643 , dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le renforcement des exigences de reporting de durabilité des sociétés est un élément clé du Pacte vert pour l’Europe. L’objectif principal de la CSRD est d’harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et d’améliorer la disponibilité et la qualité de leurs données ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ces évolutions permettront par exemple de répondre aux besoins d’information des acteurs financiers, eux-mêmes soumis à des obligations de reporting ESG. La CSRD se traduit par :
La Commission européenne a mandaté l’EFRAG – le groupe consultatif européen sur l’information financière – pour la préparation de ces normes. L’EFRAG a ainsi publié le 23 novembre 2022 douze projets de normes4 correspondant au premier acte délégué. Par ailleurs, la CSRD prévoit :
… mais qui doit reposer aussi sur des outils concretsLe rapport de l’initiative financière du PNUE expose ensuite dans sa section 2 l’évolution des solutions commerciales disponibles pour ce type d’évaluation. Elles couvrent désormais mieux l’ensemble des risques climatiques, que ce soient les risques physiques (incendies, inondations…), les risques de transition associés à de nouvelles réglementations, lois et technologies, et enfin les risques associés à la responsabilité juridique en cas de litiges (p. ex. cas d’individus ou d’entreprises cherchant des compensations suite à des pertes liées aux deux premiers types de risques). Le rapport souligne une plus grande transparence des méthodologies sous-jacentes à ces outils ainsi que l’accent mis par ces derniers sur l’élaboration de stratégies pour atteindre l’objectif de zéro émission nette avant 2050 Le rapport détaille ensuite nombre d’indications sur les approches retenues par les outils proposés sur le marché pour tenir compte des risques de transition (section 3) et des risques physiques (section 4) ainsi que les indicateurs retenus pour évaluer ces risques. En ce qui concerne la modélisation des risques physiques, le rapport pointe la nécessité d’améliorer l’évaluation de l’impact de leurs effets secondaires (migrations, conflits, crises sanitaires). La section 5 offre aux institutions financières un guide d’utilisation des outils d’analyse climatique, en mettant en évidence les cas d’utilisation les plus courants, mais aussi les défis rencontrés par les institutions financières pour intégrer les résultats dans leurs processus et leur stratégie. Pour conclure, la section 6 propose aux institutions financières une feuille de route pratique pour choisir un des outils disponibles sur le marché en fonction de leurs besoins et objectifs. Une approche ambitieuse mais qui doit être élargie selon les ShiftersIl ne faut certes pas négliger la difficulté à établir un bilan carbone généralisé à l’échelle d’un portefeuille, d’une entreprise et plus encore d’un portefeuille d’actifs financiers, à mettre en œuvre un reporting très large sur les risques climatiques et à synthétiser ces masses de données dans des indicateurs synthétiques selon des méthodologies donnant des résultats cohérents, indépendamment des pays, des noteurs… Il n’en reste pas moins que l’adoption, l’utilisation de ces outils et l’exploitation de leurs résultats par les institutions financières seront d’autant plus aisés que les acteurs de la finance auront été formés aux enjeux écologiques et à la transition climatique. À cet égard, les Shifters soulignent l’importance d’approches larges et ambitieuses en la matière. Le rapport final ClimatSup Finance5 publié en 2022 par The Shift Project propose des pistes concrètes pour assurer cette formation de façon ambitieuse, en particulier dans les fonctions les plus déterminantes des activités financières :
Par ailleurs, ce rapport propose :
Il importe de suivre les développements nombreux et complexes dans ces domaines financiers, si possible à l’échelle internationale, car leurs impacts sont à l’évidence majeurs et rapides, au-delà de la France ou même de l’Union européenne. 1 www.unepfi.org/themes/climate-change/2023-climate-risk-landscape/ 2 press.un.org/fr/2004/pnue128.doc.htm 5 theshiftproject.org/article/climatsup-finance-rapport-final/ |
Questions émissions |
|
Préservation et restauration des haiesPortée par Corinne Féret (SER-Calvados) et Jean-Noël Guérini (RDSE - Bouches-du-Rhône) En avril 2023, la Sénatrice Corinne Féret puis le Sénateur Jean-Noël Guérini ont interpellé le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur la raréfaction des haies en France et la nécessité d’une planification écologique sur le sujet. Les mesures mises en place pour inciter à la plantation n’ont pas réussi à inverser cette tendance de disparition des haies. La nécessité d’une stratégie efficaceD’après un rapport du CGAAER2 (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) publié en avril 2023, la surface en haies sur le territoire français est en constante diminution, puisque 70% du linéaire de haies a disparu des bocages français depuis 1950, avec une perte de 23 500 km par an sur la période 2017-2021. Cette érosion est historiquement liée au remembrement agricole3 et au déclin de l’activité d’élevage, ainsi qu’à une gestion insuffisante des haies, souvent considérées comme une charge et une perte de surface cultivée. La haie joue pourtant nombre de rôles allant de la préservation et restauration des écosystèmes à l’atténuation du changement climatique. Elle offre de l’ombre, capture le carbone, filtre les polluants, prévient l’érosion des sols et sert de refuge à de nombreuses espèces, y compris celles qui sont protégées. Une politique de préservation et de restauration efficace des haies est donc nécessaire afin de tenir nos engagements climat et biodiversité. Dans sa réponse publique du 29 juin 20234, le Secrétariat d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires convient de la nécessité de maintenir ou de restaurer les haies en rappelant leurs fonctions et bénéfices. Il rappelle également que des aides sont déjà en œuvre aux niveaux local, national et européen pour inciter à la plantation et valoriser les haies. Dans le cadre du plan de relance, 50 millions d’euros ont par exemple été mobilisés pour favoriser le replantage des haies. La mesure « accompagnement de la stratégie nationale de la biodiversité 2030 » du fonds vert européen prévoit également un financement possible des collectivités pour la plantation de haies via la « trame verte et bleue », à la condition de renforcer les engagements écologiques associés. En ce qui concerne l’entretien des haies, le ministère apporte un soutien aux démarches qualitatives comme le label Haie porté par l’AFAC Agroforesteries, qui pose des principes de gestion durable des haies bocagères. Les agences de l’eau soutiennent également la création et le maintien de haies par des paiements pour services environnementaux. Cependant, ces mesures n’ont pas infléchi la tendance, comme le montre la réduction croissante du linéaire de haies, avec une disparition de 11 400 kilomètres par an sur la période 2006-2014 et de 23 500 kilomètres par an entre 2017 et 20215. Ainsi, selon le sénateur Jean-Noël Guérini, un certain nombre de haies sont laissées à l’abandon ou rasées après avoir été replantées. Comme le montre le rapport du CGAAER, une planification écologique sur le sujet passe d’abord par une collecte de données précise afin de définir des objectifs, une trajectoire chiffrée et des moyens financiers en terme de maintien et plantation de haies. Une telle politique ne doit pas être dédiée uniquement à soutenir la plantation, qui ne suffit pas à endiguer l’érosion des haies. Dans une tribune parue dans Le Monde en juillet 20236, Philippe Hirou (président de l’AFAC-Agroforesteries) appelle plutôt à articuler trois leviers : valorisation, protection et reconstitution. En effet, il est important de renforcer les dispositifs permettant une valorisation des haies déjà existantes. Ces systèmes de valorisation peuvent être directs par la vente de bois-énergie issu de haies gérées durablement et certifiées, ou indirects par l’accès au bonus haie de la PAC et à des paiements pour services environnementaux. Des modèles économiques existent donc et il s’agit à présent de renforcer les financements dédiés pour permettre leur mise à l’échelle. Les agriculteurs auront ainsi l’assurance que le maintien et la gestion des haies leur fourniront à terme un revenu destiné à récompenser les services rendus par ce capital arboré. Les préconisations du Shift ProjectDans un document de travail dédié au secteur "Forêt et Bois" du Plan de transformation de l’économie française (PTEF)7, le Shift Project rappelle l’importance de favoriser la résilience des forêts face au changement climatique, afin notamment de préserver le puits de carbone qu’elles représentent. Afin que les prélèvements restent stables dans un contexte d’augmentation de la demande en bois (par exemple pour décarboner le secteur de la construction), il importe de développer la ressource en bois hors forêts, et notamment les haies. Le PTEF prévoit ainsi une multiplication par 2,5 du linéaire de haies d’ici 2050, ce qui correspond à la plantation de 900 000 kilomètres de haies en 30 ans (30 000 kilomètres par an). Ce développement est en lien avec les préconisations relatif au secteur de l’agriculture8 et à la résilience des territoires9, notamment la généralisation des pratiques agroécologiques et de l’agroforesterie qui consiste à intégrer les arbres dans les pratiques agricoles, par exemple par la plantation de haies. Un des principes de l’agroécologie est de s’appuyer sur les écosystèmes et les bénéfices de la biodiversité afin de limiter l’impact de la production agricole sur l’environnement. La généralisation de ces pratiques demandera de relever plusieurs défis comme le renouvellement, le recrutement et la formation de la population agricole. Tout l’enjeu consiste à articuler la préservation de la biodiversité, la gestion des forêts, la résilience des territoires aux pratiques agricoles. Il sera nécessaire d’accompagner les agriculteurs pour que la haie ne soit pas qu’une contrainte législative de plus mais un élément essentiel de la transition du secteur. 1 www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230406229.html et www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230406371.html 2 agriculture.gouv.fr/la-haie-levier-de-la-planification-ecologique 3 Regroupement des petites parcelles agricoles afin d’en faciliter l’exploitation 4 www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230406229.html 5 agriculture.gouv.fr/la-haie-levier-de-la-planification-ecologique 7 PTEF : Focus sur la forêt et le bois 8 Climat, crises : Le plan de transformation de l’économie française, The Shift Project (2022) 9 Climat, crises : comment transformer nos territoires ? “Cahier Campagne”, The Shift Project (2023) |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |