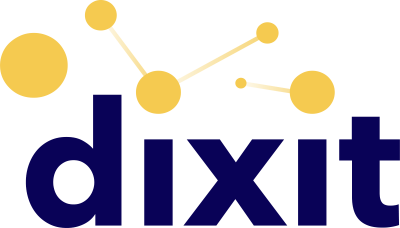La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2022 | Semaine 17Enfin ! C’est bientôt la fin des « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « 100% compensé », etc., grâce à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret, précisant l’application de la loi Climat et Résiliance et proscrivant ces mentions commerciales, cachant souvent du « greenwashing » (le cousin anglophone de notre « éco-blanchiment » national). |
|
Sommaire |
|
Questions émissions
Réflexions décarbonées |
|
Questions émissions |
|
Création d'une plateforme numérique pour centraliser les aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE)Portée par Mme Corinne Vignon (députée La République en Marche - Haute-Garonne) La députée de Haute-Garonne, Corinne Vignon, demande la création d’une plateforme internet permettant de répertorier les aides publiques disponibles pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) afin d’en faciliter la prise de connaissance par le grand public et d’inciter à leur demande. En 2018, la voiture représentait 83% des distances parcourues dans le cadre de la mobilité locale (déplacements inférieurs à 80km du domicile), elle-même contribuant à hauteur de 14% aux émissions nationales de gaz à effet de serre (GES). L’objectif fixé par The Shift Project dans son plan de transformation de l’économie française (PTEF) est d’abaisser sa part à 35% pour les mobilités locales d’ici 2050 afin de limiter les effets du changement climatique et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. En France, le quart des trajets réalisés en voiture font moins de 3 km et plus de 2 déplacements sur 3 sont effectués en voiture (en tant que conducteur ou passager) dans les villes moyennes. La voiture assure donc la majorité des trajets compris dans un périmètre d’usage du vélo : jusqu’à 7km pour un vélo « classique » et 15km pour un vélo à assistance électrique. Il est donc impératif de favoriser le report modal vers ce mode peu carboné et pour cela, le vélo à assistance électrique (VAE) a un rôle important à jouer. En effet, il permet de s’affranchir d’un certain nombre d’inconvénients propres au vélo « classique » : la difficulté physique due au relief ou aux conditions climatiques, la fatigue, la transpiration, etc. Il offre également la possibilité de parcourir de plus grandes distances. Toutefois l’achat d’un VAE est un investissement non négligeable : son prix moyen se situe entre 1 500 et 2 000 €1 et tend à augmenter. Les ménages ne le perçoivent donc pas encore comme une alternative à l’achat d’une voiture mais plutôt comme un moyen d’en réduire son usage. Comme le souligne la députée, des aides multiples existent à différentes échelles (nationale, régionale, locale : ville ou communauté de communes) mais sont peu lisibles, parfois non-cumulables entre elles, et soumises à des conditions de ressources. Cette diversité ne favorise pas la sollicitation des aides. Il paraît donc indispensable de simplifier ces démarches, les études ayant démontrés que dans une logique de report modal les stratégies d’aide à l’achat sont très efficaces. La création d’une plateforme internet pourrait effectivement être une solution efficace afin de centraliser l’ensemble des informations relatives à l’achat d’un VAE couplée à une harmonisation des subventions proposées. De son côté, l’ADEME2 recommande une centralisation de la gestion des aides au niveau de l’État pour limiter les délais et les coûts de remboursement (en particulier pour les ménages modestes) et décharger les collectivités locales, via notamment le crédit d’impôt ou le bonus écologique3. Pour aller encore plus loin, l’ADEME2 préconise l’élargissement des aides à l’achat à différents types de vélo (cargos, pliants, etc.) et aux vélos d’occasion ainsi que l’augmentation des plafonds pour les ménages modestes, à la fois pour les vélos « classiques » et pour les VAE. 1 www.quechoisir.org/guide-d-achat-velo-electrique-n8147/ 2 librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/5029-dispositifs-locaux-d-aides-a-l-achat-de-velo.html 3 www.economie.gouv.fr/cedef/bonus-ecologique-velo-electrique Liens utiles : |
Réflexions décarbonées |
|
Le décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité signe-t-il la fin du greenwashing ?
Depuis l’adoption en août 2021 de la loi Climat et résilience , on attendait avec impatience le décret encadrant plus en détail les obligations en termes d’allégations environnementales dans la communication commerciale. Après l’échec essuyé par la ministre Barbara Pompili sur son projet initial d’interdiction d’allégations éco-vertueuses dans la publicité, défendu en avril 2021 à l’Assemblée Nationale1, il était en effet attendu un tour de vis venant resserrer les dérogations admises par le texte de loi. Dans cette version, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les conditions de dérogation sont tellement draconiennes et onéreuses à respecter qu’il est raisonnable d’imaginer qu’aucun communicant n’aura envie de risquer le courroux d’une amende (ni le buzz en plus des coûts et contraintes que ses affirmations impliqueront). L’amende elle-même est virtuellement déplafonnée puisqu’elle est liée au coût de la campagne de communication, doublée en cas de récidive, et s’applique aussi aux particuliers. Toutefois, il s’agit d’un décret pouvant être « retoqué » d’ici à son entrée en vigueur, en cas de changement de sensibilité climatique de l’exécutif issu des élections en cours et des équilibres parlementaires à venir. Dans le détailL’article 1er du décret2 fournit une liste ouverte de mentions commerciales à proscrire, : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé » ou « toute formulation de signification ou de portée équivalente ». Il précise aussi que l’interdiction s’applique « à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l’affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu’aux allégations apposées sur les emballages des produits ». Le décret fait de la norme NF EN ISO 140673, ou tout autre standard équivalent, la référence à respecter pour bénéficier d’une dérogation. Elle est issue de la norme ISO 14067:20184 , considérée par la Convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique5 comme l’un des principaux moyens de contribuer à la réalisation des objectifs d’action internationale pour le climat. Le décret précise également l’étendue et la fréquence de production des bilans des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie. Ce bilan doit être mis à jour tous les ans et comporter le détail des mesures associées sur une période de dix ans si l’allégation de neutralité est liée à une stratégie d’ERC6 (évitement, réduction et compensation) ainsi que les modalités de compensation résiduelle. Ces trajectoires chiffrées doivent être revues tous les cinq ans et la dérogation qu’elles octroient s’annule dès lors que la trajectoire vertueuse s’inverse d’une année sur l’autre. Enfin, il est rappelé que toute affirmation d’ERC doit être « mesurable, vérifiable, permanente et additionnelle », que les projets d’ERC ne doivent pas « être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités et que l’affirmation de leur localisation géographique française » n’est autorisée que si 100 % de la compensation y est effectivement réalisée. L’amendement initial ainsi que son décret d’application font référence à l’avis de l’ADEME7, qui précise clairement que la neutralité carbone ne peut exister qu’à l’échelle globale ou à la limite à l’échelle d’un pays ou d’un continent car elle nécessite l’action conjointe de tous les acteurs. Cet avis ajoute que, « individuellement ou à leur échelle, les acteurs économiques, collectivités et citoyens qui s’engagent pour la neutralité carbone, ne sont, ni ne peuvent devenir, ou se revendiquer, neutres en carbone, ce qui n’a pas de sens à leur échelle. En revanche, ils peuvent valoriser leur contribution à cet objectif mondial via leurs actions respectives. » Pour mémoire le même avis précise que : «en cohérence avec le rapport 1,5°C du GIEC8, la neutralité carbone se définit par le fait de séquestrer autant de carbone que nous en émettons, de manière à stabiliser son niveau de concentration dans l’atmosphère et ainsi limiter l’augmentation de la température globale de la planète. » L’historique de la navette :Lors du passage au Sénat de la loi Climat et résilience, en commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable (ATDD), sa vice-présidente et rapporteure Mme Marta de Cidrac, sénatrice LR des Yvelines et secrétaire de la commission des Affaires Européennes, avait fait adopter une version encore plus stricte de l’amendement initial9 calqué directement sur l’avis de l’ADEME et interdisant « toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. » Lors de la séance publique du 14 juin 2021, les sénateurs ont voté l’amendement10 n°2221 de Mme de Cidrac en y introduisant un premier assouplissement à l’interdiction de principe d’allégations vertes, pour favoriser l’adoption ultérieure d’éventuels labels et standards. Cet assouplissement étant ainsi libellée : « à l’exception des formulations s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus au niveau français, européen et international. » Finalement, la version adoptée11 le 20 juillet 2021 par la Commission mixte paritaire, entièrement réécrite, maintient l’interdiction de principe mais elle en assouplit les exceptions sous condition que l’annonceur «rende aisément disponible au public » le bilan GES du produit ou service, la démarche et trajectoire selon des standards minimum fixés par décret, la charge de la preuve pesant sur l’annonceur. Cette interdiction de principe s’applique aussi aux réseaux sociaux et toute autre forme de communication, comme indiqué à l’article 2 de la directive 2006/114/CE et à l’article L581-3 du code de l’environnement12. La loi Climat et résilience du 22 août 202113, modifie le code de l’environnement, et précise dans un nouvel article L229-66 les amendes en cas de manquement : jusqu’à 20 000 € pour les particuliers et 100 000 € pour les personnes morales, sommes portées jusqu’à «la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale » et doublées en cas de récidive. Il restait donc à définir plus en détail ce que le texte de loi considère comme suffisamment clair et précis en matière de preuve de vertu de l’annonceur et ses produits, ainsi que l’étendue des obligations en termes de délais, effets de seuil et conditions d’annulation des dérogations. C’est chose faite avec ce décret, pour l’instant, en attendant la prochaine saison de cette série à rebondissements. Le marché de la communication14 a atteint 31 Mds d’euros en 2021, en croissance déjà estimée à 34 Mds € en 2022. Si l’on y ajoute les 12 Mds de coûts des ressources humaines dans les services de communication, pour un total de plus de 2 % du PIB15, on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette ponction annuelle sur le pouvoir d’achat des Français. On comprend ainsi d’autant plus l’utilité de lier l’amende pour éco-blanchiment (greenwashing) au moins au coût du larcin, à défaut de pouvoir la lier au butin de la vente générée grâce à l’allégation trompeuse, voire au coût réel de remise en état de l’environnement en mode pollueur-payeur, augmenté des préjudices subis par les victimes des pollutions industrielles16. 2 www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611 4 www.iso.org/fr/news/ref2317.html 7 librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html 8 www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf 9 www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/551/Amdt_COM-4.html 10 www.senat.fr/amendements/2020-2021/667/Amdt_2221.html 11 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4336_texte-adopte-commission#D_Article_4_bis_C 12 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834686/ 14 www.francepub.fr/le-marche-de-la-publicite-bilan-annuel-2021et-previsions-pour-lannee-2022/ 16 www.cabinetaci.com/les-differents-prejudices/ Liens utiles :
➤ The Shift Project - Écoblanchiment dans la communication financière et les stratégies d’investissement (2018)
➤ The Shift Project - Bilan mitigé du Projet de loi relatif à l’énergie et au climat (2019) ➤ The Shift Project - Étude sur la transition énergétique via l’approche par scénarios (2019) ➤ The Shift Project - Scénarios énergie-climat : évaluation et mode d’emploi (2019) ➤ The Shift Project - Analyse du décret relatif à la Stratégie Nationale Bas-Carbone et aux budgets carbone (2020) ➤ The Shift Project - Stratégies de Résilience des territoires (2021) ➤ The Shift Project - Stratégies de décarbonation des candidats à l’élection présidentielle (2022) |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |