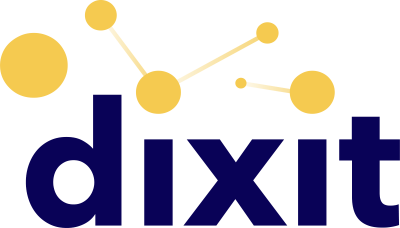La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2022 | Semaine 16L’élévation du niveau des mers et des océans, une conséquence du dérèglement climatique, érode nos côtes et littoraux. On s’interroge, comme souvent dans la Gazette : quelles solutions pour en éviter les conséquences aujourd’hui, sans empirer la situation demain ? |
|
Sommaire |
|
Notre sélection de la semaineQuestions émissions |
|
Notre sélection de la semaine |
|
Le Fonds Erosion Côtière (FEC), nouvel outil à la portée incertaineProposition portée par Mme. Sophie PANONACLE (Députée de la Gironde - LREM) Une proposition de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale fin février souhaite instaurer un Fonds Erosion Côtière destiné à financer les coûts liés à l’érosion des littoraux français. Elle viendrait prolonger la loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021, et compléter le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (dit « Fonds Barnier ») qui ne concerne pas les phénomènes érosifs. Il y a urgenceLe problème à traiter est crucial. La hausse du niveau des mers pourrait atteindre 84 cm d’ici à 2100 selon le GIEC1 , et encore, cette valeur étant peut-être sous-évaluée par les modèles. L’érosion existante des littoraux va se poursuivre et s’accentuer, même dans l’hypothèse la plus optimiste d’une maîtrise complète du réchauffement climatique (+43 cm de hausse selon le GIEC). Le recul actuel du trait de côte concerne 20% du littoral français (920 km) et représente 30 km2 perdus sur la période 1960-20102 . 37% des côtes sableuses sont en recul, en particulier dans la Gironde, Les Bouches du Rhône et le Languedoc3 , sachant que ponctuellement, ce recul peut atteindre jusqu’à 3m/an. Parer au plus pressé et anticiperLe texte est justifié par une étude du CEREMA pointant une menace potentielle pour 50.000 habitations d’ici à 2100, représentant une valeur immobilière de 8 milliards d’euros4 , si le pire des 6 scenarii étudiés se concrétise, c’est à dire, la disparition des ouvrages de protection actuels sur tout le littoral. La création du FEC répond alors à un besoin des communes qui devront investir au-delà de ce que leurs moyens financiers leur permettraient. Avec le FEC, ils pourront lancer :
Le FEC concerne les communes qui ont accepté d’intégrer le dispositif proposé par l’État (soit 119 selon le projet de décret en cours) et sera financé par le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Un texte en questionsLa proposition concerne peu la décarbonation de l’économie (renaturation d’un côté, mais relocalisations de l’autre), et surtout l’adaptation aux conséquences de la carbonation. Ces dépenses n’ont de pertinence que si, en parallèle, la maîtrise des rejets de CO2 est effective, sans quoi l’élévation du niveau des mers et des océans se poursuivra. La proposition de loi interroge à plusieurs titres.
Pour aller plus loinPlusieurs réflexions s’imposent.
1 www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/ 2 www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-acheve-realisation-indicateur-national-erosion 3 www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/premiers-enseignements-r476.html 5 www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2015_Littoral_WEB.pdf 6 www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-risques-littoraux-et-des-tsunamis-en-france 7 The Shift Project, Climat, crises : le plan de transformation de l’économie française, Paris, Odile Jacob, 2022 |
Questions émissions |
|
Réécriture : Reprise du transport aérien et lutte contre le dérèglement climatiqueQuestions émissions M. Roger Karoutchi (Sénateur des Hauts-de-Seine - Les Républicains) A la suite de plusieurs commentaires de votre part sur cet article publié le 5 avril, nous avons fait le choix de vous le soumettre une seconde fois, tout en ajoutant les compléments et modifications nécessaires. M. Roger Karoutchi attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les contraintes toujours plus fortes qui pèsent sur le secteur du transport aérien en matière environnementale, et son impact sur la compétitivité du transport aérien européen. […] Contexte Les sujets de l’aviation et l’aéronautique sont, de nos jours, enclins à polémique et crispation, à la fois du côté des politiques et du grand public. Ces comportements s’expliquent par le fait que le secteur aérien participe au positionnement de la France comme première destination touristique mondiale. L’avion joue également un rôle important dans le désenclavement des territoires et l’animation des échanges nationaux et internationaux. Cependant, l’aviation civile mondiale a émis environ 2,5% des émissions mondiales de CO2 en 2018 (environ 1,1 GtCO2) et ces émissions ne cessent d’augmenter (+45% entre 2005 et 2019) à cause de la croissance du trafic aérien. A l’échelle de la France, la mobilité longue distance (trajet >80 km du domicile) représente 9% des émissions de GES avec 85% des distances parcourues en avion ou en voiture. Même s’il ne représente que 2% des voyages en France, l’avion long-courrier contribue à l’émission d’1/3 des GES du secteur de la mobilité longue distance. Une réflexion pour la décarbonation de ce secteur paraît donc légitime. Passer de la contrainte à l’opportunité de résilience Selon M. Karouchi, « il n’est pas question de remettre en cause les objectifs européens de réduction des émissions » mais « la hausse des prix des billets n’aidera pas [le transport aérien] à retrouver le taux de fréquentation de l’ère pré-Covid ». Faut-il donc supposer conciliables les objectifs de réduction des émissions et de restauration du trafic ? Supaero Décarbo et The Shift Project indiquent dans leur rapport « Pouvoir voler en 2050 », différentes propositions pour décarboner le secteur de l’aviation tout en prenant en compte les risques qui lui incombent tels que la perte d’emplois, la perte d’un savoir-faire unique ainsi que l’épuisement de ressources fossiles. En premier lieu, un budget carbone mondial du secteur (quantité totale de GES que le secteur peut émettre d’ici 2050) doit être défini puis, seulement à ce stade, une trajectoire de réduction des GES au niveau national et international, peut être envisagée. “Pour respecter les objectifs de la Stratégie National Bas Carbone dans le secteur aérien, il existe plusieurs mesures possibles au niveau national :
Toutes ces mesures peuvent être appliquées rapidement à l’échelle de la France mais doivent être généralisées à l’international pour être efficaces. En termes d’emploi, l’industrie aéronautique doit se diversifier, encouragée par la puissance publique, afin de limiter les risques d’un « syndrome de Détroit ». La création d’une Alliance industrielle pour le climat pourrait être une solution. Elle aurait en charge d’élaborer et de conduire de grands programmes d’équipements et de services pour décarboner l’économie, d’accroître à la fois la résilience et la compétitivité de l’industrie européenne. Croissance de la fréquentation et baisse des émissions : un doux oxymore Dans son rapport Supaero Décarbo indique que l’un des objectifs primaires de l’aéronautique est la recherche permanente de l’efficacité énergétique. En effet les appareils les plus récents peuvent consommer 15 à 20% de moins que ceux de la génération précédente. Toutefois, les solutions techniques ne suffiront pas à rendre le secteur sobre en énergie et en carbone. Face aux nombreuses inconnues que le futur nous réserve, toute politique de réduction des émissions de CO2 liées au trafic aérien qui n’inclurait pas la possibilité de réduire la demande expose le secteur à des risques importants quant à sa résilience, et donc sa durabilité. Un retour aux taux de fréquentation pré-Covid irait à l’encontre des propositions formulées par le Plan de Transformation de l’Économie Française (PTEF) du Shift Project, pour positionner le secteur sur la trajectoire de baisse des émissions fixées par l’accord de Paris. De plus, la baisse des émissions que permettrait la défragmentation du ciel des États européens, suggérée par ailleurs par le sénateur, s’avérerait dans tous les cas insuffisante et très éloignée de l’objectif de 5% de baisse annuelle par rapport aux émissions actuelles. Une réflexion sociétale sur le rôle de l’aviation dans un monde bas carbone est la meilleure façon d’intégrer la contrainte climatique dans un vrai projet de transformation, plus sobre en usage. Liens utiles : |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |