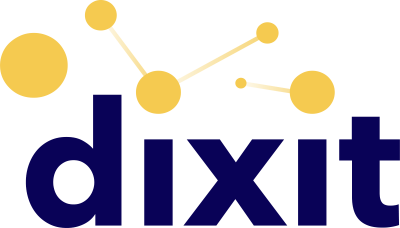La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2022 | Semaine 13La Gazette du Carbone publie cette semaine la réponse des Shifters à une consultation publique du Ministère de la transition écologique sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi « climat et résilience » portant sur le zéro artificialisation nette des sols. Cette analyse est suivie d’une réflexion sur la place du gaz fossile (dit « gaz naturel ») dans le mix énergétique des logements français et des répercussions de l’instabilité géopolitique sur les ménages les plus modestes. Bonne lecture ! |
|
Sommaire |
|
Nos dernières actions
Questions émissions |
|
Nos dernières actions |
|
Objectif zéro artificialisation des sols - Que disent les décrets d'application de la "loi climat"?Réponse des Shifters à une Consultation Publique du ministère de la Transition Ecologique Un peu de contexte La loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, a fixé à 2050 l’arrêt de l’artificialisation des sols sans que soit renaturalisé un sol de même surface en compensation, c’est ce que l’on appelle « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). Afin de freiner le rythme moyen de 20 000 à 30 000 hectares espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) consommé par an en France1 , le texte de loi dessine une trajectoire de réduction en trois tranches de dix ans. La première tranche doit diminuer ce rythme de moitié par rapport à la décennie précédente2. Cet objectif est crucial car, d’une part, en préservant la possibilité de mise en œuvre de puits de carbone, il sert la stratégie climatique de la France et, d’autre part, en limitant l’étalement urbain, il permet de repenser les modalités de déplacements quotidiens. La consultation publique du Ministère de la transition écologique vise a préciser la mise en oeuvre de la loi Climat et Résilience et porte sur trois projets de décret d’application :
Cette intégration de l’objectif ZAN dans les documents d’urbanisme doit s’effectuer dans un calendrier contraint, desserré par la loi « 3DS » : la plateforme de discussion ad hoc, la Conférence des SCOT, a jusqu’au 22 novembre 2022 pour formuler des propositions concertées de territorialisation et pour les régions d’arrêter leur SRADDET. Une amélioration de l’atténuation des émissions GES et de l’adaptation ? Ces projets de décret viennent circonscrire juridiquement un modèle d’urbanisme français, marqué par une prévalence de l’habitat pavillonnaire et ses besoins de dessertes qui ont été le principal vecteur d’un rythme soutenu d’artificialisation des sols, 4 fois supérieur à la croissance de la population. Ils ont le mérite de placer les documents d’urbanisme local dans un rapport juridique de compatibilité par rapport à la planification régionale pour sécuriser l’opérativité du nouvel objectif. De plus ils proposent des mesures d’accompagnement à travers la livraison de données et la mise en place d’outils numériques qui facilitent l’analyse des données fournies3. Les acteurs publics de l’urbanisme bénéficieront, à l’occasion de la Conférence des SCOT, d’une opportunité de repenser la place de la construction neuve dans les dynamiques territoriales. La réalisation de l’objectif ZAN pour 2050 inscrit dans la loi, nécessite une forte anticipation pour être menée à bien. Une modélisation du besoin de logements neufs avec le stock de logements existants dans un scénario ZAN, a mis en évidence que sa réussite passe par une réduction rapide de la construction de maisons individuelles neuves et de l’habitat secondaire, un maintien du niveau de construction de logements collectifs, ainsi qu’une priorisation du renouvellement urbain. Par ailleurs, ces réorientations ne sauraient faire l’économie d’évolutions des comportements individuels dans un nouveau modèle d’urbanisme durable. Le projet de décret indique que les SRADDET devront prendre en considération dans la déclinaison territorialisée de l’objectif ZAN les besoins induits par les dynamiques démographiques et économiques et les équilibres territoriaux. Ces dynamiques devraient être infléchies par les mesures incitatives, à l’heure où l’étalement urbain sera de plus en plus contraint, afin qu’une partie du besoin en nouveaux logements trouve satisfaction dans des territoires, en dehors des aires métropolitaines, ayant un taux de vacance sensible. Le Shift Project préconise, pour les stratégies territoriales, de privilégier les dispositifs de planification de droit commun aux outils de contractualisation tel que le Contrat de Plan Etat Région (CPER) ou les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), afin de faciliter l’alignement et la cohérence des politiques d’aménagement ; là où les pouvoirs publics flèchent les moyens alloués aux collectivités territoriales dans la lutte contre l’artificialisation à travers des projets d’investissements (programmes Action Cœur de Ville, Petites villes de demain ou encore Fonds friche)4. Le cadre établi par ces trois projets de décrets crée les conditions nécessaires à la préservation des capacités de production agricole des territoires bordant les métropoles qui sont fondamentales pour re-territorialiser les systèmes alimentaires et le développement des stratégies locales de résilience alimentaire. Il s’agit d’un enjeu essentiel à la résilience des territoires, qui doit être pensé simultanément et en interaction au moment de remettre les documents de planification sur la table de travail, pour définir une limitation de l’étalement urbain. De même, la révision des documents locaux d’urbanisme crée l’opportunité d’une intégration de la stratégie et du plan d’actions issus du PCAET5 pour que cette relecture soit faite sous le prisme de la résilience. Quelles marges de manœuvre supplémentaires ? Le niveau d’ambition louable de l’objectif ZAN d’ici 2050, questionne la capacité de ces projets de loi à sécuriser la trajectoire fixée par la loi Climat et Résilience. Les remontées des rapports de suivi locaux seront un indicateur décisif de la réception de la réforme et de la qualité de sa mise en œuvre. Il ne faut donc pas exclure de changer le lien juridique de la compatibilité vers la conformité entre le SRADDET et les documents d’urbanisme opposables. Enfin, lors des concertations pour la révision de la planification territoriale, la capacité de renaturalisation ne doit pas être surestimée. En effet, compte tenu des dépenses financières et énergétiques que ce procédé implique, la renaturalisation ne peut avoir qu’une portée marginale, à la différence du renouvellement du bâti, faisant la part belle à la densification urbaine et l’accès aux logements vacants. 1 MTE, Note blanche Lutte contre l’artificialisation des sols : www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sol 2 Article 191 de la loi Climat et Résilience : www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957220 3 Le suivi de la consommation d’espaces NAF : artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf 4 Circulaire du 30 août 2021 relative à la contractualisation et à la planification locale pour lutter contre l’artificialisation des sols : www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0032098&reqId=c0668056-9a1b-457c-861f-b38bba249039&pos=1 5 PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial, obligatoire pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants Liens utiles :
➤ The Shift Project - PTEF : focus sur l’agriculture et l’alimentation - octobre 2020
➤ The Shift Project - Habiter dans une société bas carbone - Octobre 2021 ➤ The Shift Project - Stratégies de résilience des territoires - Tome 2 : Agir ➤ The Shift Project - Stratégies de résilience des territoires - Tome 3 : Organiser |
Questions émissions |
|
Prix du gaz en habitat collectif, les grands oubliés du bouclier tarifairePortée par M. Fabien Gay (Seine-Saint-Denis - CRCE) Le député M. Fabien Gay attire l’attention sur l’exclusion des contrats collectifs des mesures décidées dans le cadre d’un bouclier tarifaire destiné à pallier la hausse considérable des tarifs de l’énergie. […] En effet les organismes de logements sociaux, au sein desquels le gaz est une énergie fréquemment utilisée, subissent ces hausses de plein fouet. […] Il demande donc que le dispositif du chèque énergie soit assoupli afin que les bailleurs sociaux puissent en bénéficier directement, et d’autre part que son montant soit augmenté afin qu’il se trouve davantage adapté à la hausse massive des tarifs. La question de notre dépendance au gaz naturel fait écho à la communication récente du gouvernement, paru le 16 mars dans un communiqué, au sujet du retrait des chaudières à gaz du dispositif MaPrimeRénov, prévu initialement à partir du 1er avril 2022, puis finalement repoussé au 1er janvier 20231. La situation actuelle nous force à nous confronter à notre forte dépendance au gaz naturel, appelé dans cet article « gaz fossile ». La France importe en effet la quasi-totalité de son gaz de l’étranger. 20% de nos importations provenaient de la Russie en 2019, 2ème fournisseur derrière la Norvège, avec 36% de nos importations2. 31 % du gaz fossile importé par la France est destiné au secteur résidentiel, où il est utilisé pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Le gaz alimente en effet 37% du mix énergétique des logements français, d’après le Haut Conseil pour le Climat3 (données Odyssée, année 2017). En 2018, The Shift Project (TSP) a produit un article intitulé Le financement des chaudières gaz par le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) : Les nouveaux gilets jaunes. TSP identifiait déjà un effet de « ciseau fiscal » touchant durement les ménages les plus modestes. Ces derniers sont, en effet, coincés entre, d’une part, une politique d’efficacité énergétique d’aide aux équipements de chauffage fossiles au fioul et au gaz et, d’autre part, une politique climatique de fiscalité carbone qui décourage la consommation des mêmes combustibles fossiles. Plus récemment, dans son Plan de Transformation de l’Économie Française (PTEF), TSP insiste à nouveau sur la nécessité de sortir au plus vite des combustibles fossiles pour chauffer nos logements. Les alternatives identifiées sont, par ordre de priorité, les réseaux de chaleurs pour les logements collectifs, les pompes à chaleur et la biomasse : 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que la priorité reste avant tout de réduire la demande en énergie par la rénovation énergétique, comme le souligne à plusieurs reprises le PTEF. 1 https://www.batiactu.com/edito/maprimerenov-etat-offre-un-repit-chaudieres-gaz-63797.php 2 BP Statistical Review of World Energy 2020 : www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf 3 Chiffres clés de l’énergie édition 2021, année 2019 : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition-2021 4 « Haut Conseil Pour le Climat : RÉNOVER MIEUX : LEÇONS D’EUROPE » – Novembre 2020 : www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/11/hcc_rapport_renover_mieux_lecons_deurope.pdf Liens utiles : |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |