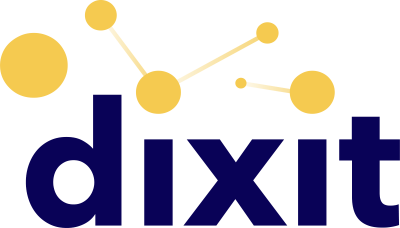La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2022 | Semaine 12Dans la Gazette du carbone de cette semaine, vous découvrirez un premier article sur un sujet méconnu mais non moins intéressant, le fret fluvial sur les petits canaux (dit « canaux Freycinet »), ainsi qu’une réflexion sur la compensation carbone. |
|
Sommaire |
|
Questions émissions |
|
Questions émissions |
|
Fret fluvial : sauvegarde des canaux "petit gabarit"Portée par M. Bruno Sido (Haute-Marne - Les Républicains) Dans une question écrite adressée à la ministre de la transition écologique, le sénateur Bruno Sido s’inquiète de l’allocation, par le nouveau contrat d’objectif et de performance, de moyens et d’investissements suffisants pour la conservation et la restauration du réseau fluvial de canaux de « petit gabarit », dit gabarit « Freycinet ». Le transport fluvial est un mode de transport considéré comme écologique car peu émetteur de GES (4 à 5 fois moins de CO2 à la tonne.km par rapport au transport routier), relativement silencieux, capacitaire, peu consommateur d’espace, etc. La France possède, de plus, le plus long réseau de voies navigables en Europe (8 500 km) dont 6700 km sont gérées par VNF (Voies Navigables de France) et composées :
Ce mode est, pourtant, aujourd’hui largement sous-exploité, représentant 3 % de la part modale du transport de marchandises, alors que les infrastructures actuelles permettraient d’en transporter 4 fois plus. Il souffre d’un manque de compétitivité notamment lié aux surcoûts de la manutention fluviale et aux ruptures de charges. Toutefois, après des années de sous-investissement, l’État semble renouer avec une vraie ambition de développement du fret fluvial qu’il décline dans le Contrat d’Objectif et Performance 2020-20291 signé le 30 avril 2021 avec VNF : l’objectif, à horizon 2030, est d’augmenter de moitié le volume de fret à transporter (soit plus de 10 milliards de tonnes-kilomètres ou plus de 75 millions de tonnes en volume) et de multiplier par deux les retombées économiques en lien avec le tourisme fluvial. VNF va ainsi bénéficier jusqu’en 2029 de capacités d’investissements de 300 millions d’euros2 en moyenne par an, alors qu’elles n’étaient que de 190 millions en 2019, pour le renouvellement, la modernisation, le développement du réseau fluvial et l’amélioration du service. Concernant le fret, l’accent est mis sur le développement des voies « à grand gabarit », la logique urbaine et l’amélioration de la chaine logistique. Toutefois le réseau « à petit gabarit » est également concerné, même si les montants précis ne sont pas clairement précisés, notamment par la modernisation de certaines infrastructures (télécommande des écluses) ou encore un travail partenarial avec les collectivités de valorisation de ces réseaux. Ces mesures et investissements sont cohérents avec les propositions faites par The Shift Project pour mieux valoriser et développer le fret fluvial. Il s’agit d’un bon premier pas pour exploiter les infrastructures existantes à leur pleine potentialité, à condition cependant, de maintenir voire d’augmenter les moyens humains de VNF, nécessaires à la gestion et mise en œuvre de ces investissements. Les pas suivants devront toutefois se montrer plus ambitieux et plus rapide encore, en particulier sur les centres de transfert/logistique multimodaux, pour atteindre les objectifs fixés par le PTEF : une multiplication par 9 du flux de marchandises transporté par voie fluviale, via un report modal massif. 1 « Contrat d’objectifs et de performance entre l’État et voies Navigables de France, 2020-2029 » : www.cfdt-vnf.fr/wp-content/uploads/2021/03/COP-Texte-integral.pdf 2 Site de VNF : www.vnf.fr/vnf/investissements-record-pour-le-fluvial-vnf-investira-pres-de-345-millions-deuros-en-2022/ Liens utiles : |
|
Compensation carbone : une fausse bonne idée ?Portée par M. Dominique Potier (Socialistes et apparentés - Meurthe-et-Moselle) La France a pris l’engagement, le 12 novembre 2021, de ne plus offrir de financement public ou de garantie publique sur les emprunts pour les projets d’énergies fossiles à l’étranger, si ces derniers ne mettent pas en place des systèmes de compensation des émissions de carbone dès 2022. L’objectif de cette mesure est le respect des Accords de Paris de 2015 (COP 21), à savoir atteindre la neutralité carbone. On appelle neutralité carbone, l’équilibre entre les émissions de GES et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone. Ces derniers sont des réservoirs naturels (forêts ou océans) ou artificiels (capture et stockage du carbone) qui exercent une influence importante sur le climat de la planète. Dans une question écrite datant de décembre 2021, le député Dominique Potier interroge la ministre en charge de la transition écologique sur la réglementation mise en place sur les systèmes de compensation carbone pour limiter leurs dérives, notamment la spéculation déjà identifiée sur ces marchés. La compensation carbone vise à contrebalancer une émission de GES par le financement parallèle d’actions visant à la séquestrer afin que l’émission initiale soit finalement neutre. De manière surfacique, la compensation carbone semble être un moyen d’atteindre la neutralité carbone, objectif repris par le PTEF. Néanmoins, le rapprochement entre compensation carbone et neutralité carbone est moins évident qu’il n’y paraît :
Alain Karsenty, chercheur au Cirad1, précise par ailleurs qu’il est impossible d’établir une stricte équivalence entre la tonne de CO2 émise et celle soustraite, « en raison des externalités négatives, notamment sur l’environnement et la santé, liées à l’émission d’une tonne de CO2 ».2 Enfin, les compensations carbones sont utiles si elles sont réservées aux émissions incompressibles, c’est-à-dire, après avoir d’abord réduit ses émissions au maximum. Certaines compagnies aériennes et pétrolières utilisent, en effet, ces dispositifs pour compenser leurs émissions sans les réduire et s’en servent comme arguments publicitaires, à la limite du greenwashing. Les compensations carbones ne doivent pas devenir un frein aux évolutions des comportements individuels et collectifs de réduction des émissions de GES. Pour responsabiliser les producteurs et les consommateurs, un projet de décret relatif à la compensation carbone et aux mentions de neutralité carbone dans la publicité3, lancé par le Ministère de la Transition Écologique, a été soumis à consultation publique en février dernier. Il vise notamment à réglementer la communication des annonceurs de neutralité carbone en leur imposant la réalisation d’un bilan d’émissions de GES du produit ou du service considéré. De plus, le décret interdirait la mention de neutralité carbone si les émissions liées au produit augmentent d’une année à l’autre. Enfin, il est important de noter que le GIEC, dans son dernier rapport, alerte sur la probable perte d’efficacité des puits de carbone océaniques et terrestres dans les prochaines décennies si les émissions de GES ne cessent d’augmenter. 1 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 2 « La compensation carbone sous le feu des critiques » – Novembre 2019 : 3 Projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité – Janvier 2022 : www.vie-publique.fr/consultations/283391-projet-decret-allegations-neutralite-carbone-dans-publicite-loi-climat Liens utiles : |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |