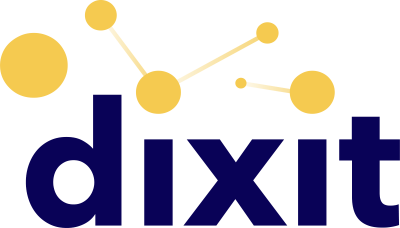La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2021 | Semaine 50On a attendu la fin du mois de décembre pour vous parler de soleil… et donc de panneaux photovoltaïques, que certains souhaitent installer dans les zones exposées aux feux de forêt, d’autres dans les parcs de leurs châteaux. Mais des solutions, pour les motivé(e)s de la décarbonation, nous en avons toujours ! Réflexions de Shifters. |
|
Sommaire |
|
Questions émissions |
|
Questions émissions |
|
La pose de panneaux photovoltaïques est avant tout un choix politiqueQuestion posée par Jean-Claude Bouchet (Député du Vaucluse - Les Républicains) Le député Jean-Claude Bouchet interroge la ministre de la Transition Écologique sur le déploiement de panneaux photovoltaïques dans les territoires exposés aux feux de forêt. Dans ces zones, les Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF) réglementent les nouvelles constructions, ainsi que la pose de panneaux solaires. Les panneaux sont en effet des points sensibles, augmentant le risque de départ de feu. Pour exploiter le potentiel de ces départements très ensoleillés (Bouches-du-Rhône, Gironde…), le député demande des moyens pour concilier la prévention incendie avec l’installation de panneaux solaires. La réglementation des installations solaires dans les zones exposées aux feux de forêtLes Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) ont été institués par la loi Barnier du 2 Février 1995. Par ce dispositif, les préfectures instaurent un cadre réglementaire pour les communes de leur département exposées aux feux de forêts. Concrètement, le PPRIF dresse une cartographie du territoire par niveau de risque. Dans les zones rouges, qui sont les plus exposées, la pose de panneaux solaires est strictement interdite. Dans les zones d’aléa moyen, les installations photovoltaïques peuvent être autorisées au cas par cas, en fonction de la localisation et des moyens de protection mis en place. Il existe donc une marge de manœuvre pour favoriser les panneaux solaires dans ces espaces. Une goutte d’eau dans l’encadrement des centrales photovoltaïquesCependant, la prévention incendie n’est pas le principal obstacle à l’installation de centrales photovoltaïques. De multiples contraintes et risques sont pris en compte avant de les autoriser : inondations, proximité d’un aérodrome, zones humides ou protégées, paysages remarquables, etc. Pour ce qui est des panneaux solaires au sol (hors toitures), la réglementation ministérielle demande qu’ils soient déployés uniquement sur des sites déjà artificialisés, comme les friches et parkings. Les espaces naturels, agricoles et forestiers ne peuvent pas, par principe, être dotés de centrales solaires (Ministère de la Transition Écologique, Guide sur l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol, 2020). Cette règle, qui vise à faire en sorte que les panneaux photovoltaïques ne soient pas une cause supplémentaire d’artificialisation des sols, limite très fortement leur développement en France. Un choix politique nécessaire dans l’utilisation des sols et l’approvisionnement énergétiqueIl est en effet inhérent aux énergies renouvelables (solaire, éolien notamment) d’impliquer une consommation d’espace, handicap majeur que ne connaissent pas les énergies fossiles. |
|
Monuments historiques : une transition énergétique possibleQuestion posée par Christophe Blanchet (Député du Calvados - MoDem et Démocrates apparentés) Dans sa question à Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, M. Christophe Blanchet s’inquiète des difficultés rencontrées par certains propriétaires de monuments historiques pour concilier la lutte contre les émissions de CO2 avec les contraintes résultant de la protection de leurs abords. Sa question porte plus particulièrement sur l’interdiction d’installation de panneaux photovoltaïques à moins de 500 mètres desdits monuments. Les deux leviers les plus importants pour baisser les émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment ne sont pas l’installation de panneaux photovoltaïques, mais une sobriété énergétique accrue grâce à une meilleure isolation et l’installation d’un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire moins carboné excluant l’usage du fioul et du gaz naturel. Il s’avère que ces deux leviers peuvent s’appliquer aux bâtiments du patrimoine en général et dans le cas cité par monsieur le député en particulier. La réhabilitation de bâtiments à caractère patrimonial peut néanmoins s’avérer plus complexe que pour des bâtiments plus récents, mais plusieurs initiatives récemment citées par une note de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique1 montrent que cela est possible. La première est le centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien (CREBA)2 qui propose une charte de réhabilitation responsable du bâti ancien ainsi que des retours d’expérience détaillés. L’observatoire BBC3 permet également d’accéder à des centaines de retours d’expérience de réhabilitation énergétiques réussies de bâtiments du patrimoine. Enfin, le label Effinergie Patrimoine4 permet de valoriser les réhabilitations exemplaires en la matière, suite à un processus incluant une commission rassemblant des architectes (ABF, architectes du patrimoine, etc.) et des thermiciens. Bon courage aux châtelains ! |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |