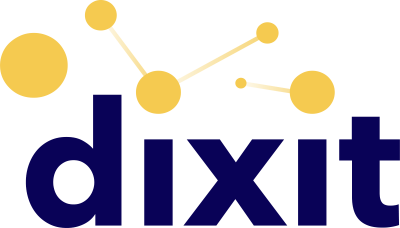La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2021 | Semaine 49La Gazette du Carbone relaye cette semaine la réponse du Shift Project à une consultation publique de la mission interministérielle « Green Tech » sur l’écoconception des services numériques. Et puis, pour les amoureux du train, vous trouverez en deuxième partie une réflexion sur le train français face à la concurrence, les coûts d’entretien du réseau et les incertitudes quant à l’avenir des « petites lignes ». |
|
Sommaire |
|
Notre sélection de la semaineQuestions émissions |
|
Notre sélection de la semaine |
|
Mission interministérielle "Green Tech" : réponse du Shift Project à une consultation
Alors que la première loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique vient d’être votée par le Parlement, la mission interministérielle « Green Tech » lance un Référentiel Général d’Écoconception des Services Numériques (RGESN). Décryptage par des Shifters, qui se sont penchés sur le sujet pour contribuer à la consultation publique. Depuis 2018, The Shift Project a conduit des travaux sur l’impact environnemental du numérique. Ses rapports ont contribué à une prise de conscience de l’empreinte croissante du numérique sur l’environnement et des raisons systémiques amenant à cette situation. Le numérique est au cœur des transformations de notre société. Mais les émissions de GES de ce secteur augmentent de 6% par an, et pourraient doubler d’ici 20251. Une telle croissance est incompatible avec les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et exerce de surcroît une pression insoutenable sur les matières premières. Réduire l’impact environnemental du numérique représente un enjeu sociétal majeur, pour donner aux systèmes numériques une trajectoire compatible avec les contraintes énergie-climat. The Shift Project estime que la progression des émissions de GES pourrait être ramenée à 1,5% en adoptant la sobriété numérique comme principe d’action. Inscrite dans la feuille de route interministérielle Numérique et Environnement, la mise à disposition d’un Référentiel Général d’Ecoconception des Services Numériques (RGESN) élaboré par la mission « GreenTech » (associant la DINum, le MTE, l’ADEME et l’INR) témoigne d’une mobilisation accrue sur ce sujet. Il représente à la fois un signal positif en direction de l’ensemble des acteurs publics et privés, et une avancée vers des services numériques plus sobres et durables. Les points forts du RGESN :
Les sujets à approfondir
Pour aller plus loin
1 Impact environnemental du numérique : tendances à 5 ans et gouvernance de la 5G Liens utiles : |
Questions émissions |
|
L'avenir du train : concurrence, "petites lignes" et entretien du réseauQuestion posée par Alexis Corbière (La France insoumise – Seine-Saint-Denis ) Le député Alexis Corbière interpelle le Ministre délégué aux transports sur les moyens financiers qui vont être mis en œuvre pour l’entretien du réseau ferroviaire français, notamment celui des « petites lignes » afin de garantir aux usagers une qualité de service et un niveau de sécurité effectifs. Il lui demande également quelles sont les garanties, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, de maintien des lignes de desserte fine qui permettent le désenclavement de certains territoires et contribuent largement à la politique de décarbonation du pays. L’entretien du réseau ferroviaireLe nouveau contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, pour les 10 prochaines années, a été présenté début novembre 2021 au conseil d’administration de SNCF Réseau. Il fait actuellement l’objet d’un processus de consultation. Ce nouveau contrat de performance limite l’installation de « commandes centralisées du réseau » sur une seule partie du réseau français —uniquement sur Marseille – Vintimille. Concrètement, cela signifie le maintien de postes d’aiguillages obsolètes actionnés « à la main » alors qu’une commande centralisée permet de substantiels gains de productivité et financiers. Sur la partie financière, le contrat de performance prévoit un cash flow positif à partir de 2024. Les bénéfices de SNCF Voyages (l’entité faisant circuler les TGV et Intercités) doivent être reversés au gestionnaire d’infrastructure : SNCF Réseau. Mais SNCF Réseau risque d’être concurrencé sur ses liaisons les plus rentables par d’autres acteurs, notamment Trenitalia entre Paris et Lyon, qui seront exonérés de verser leurs dividendes au gestionnaire d’infrastructure ! Il manque à ce contrat de performance une vision stratégique et des indications sur le dimensionnement du réseau. En outre, ce contrat prévoit de la régénération (c’est-à-dire de la remise à l’identique), mais pas d’actions de modernisation du réseau, ce qui signifie que SNCF Réseau devra financer ces dernières sur fonds propres. Sur le maintien des lignes de dessertes fines du territoire dans un contexte de concurrenceL’État a segmenté le réseau ferroviaire de la manière suivante pour les infrastructures :
Pour les LDFT, on peut imaginer les Régions plus volontaires que SNCF pour ces lignes appelées « pompeusement » petites lignes. Dans les faits, ce sont souvent ces lignes dont l’état est le plus dégradé et qui nécessitent le plus d’investissement. Il n’est pas certain que les Régions aient les moyens financiers de toutes les sauver, même en imaginant des dispositifs plus frugaux. Une LDFT doit faire l’objet d’une convention de transfert entre SNCF Réseau et la Région. Cette convention doit traiter des éléments financiers. À ce jour, aucune convention de ce type entre une Région et SNCF n’a été signée. Source : Liens utiles : |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |