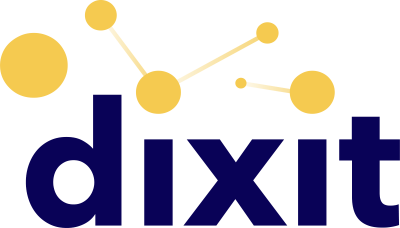La gazette du carbonePour un arsenal juridique décarbonant |

|
|
Chaque semaine, nos propositions tirées de l’expertise du Shift Project pour intégrer les enjeux climatiques au débat parlementaire.
2023 | Semaine 38Bonjour chères lectrices et chers lecteurs ! La transition énergétique ne se fera pas à coups de slogans. La déclinaison du Plan de Transformation de l’Économie Française met souvent en exergue la complexité des différents enjeux qui se croisent et la nuance avec laquelle il convient de trouver un chemin de crête conciliant la nécessité de mutations drastiques et l’atténuation des disruptions économiques et sociales. Rien de tels que d’exemples concrets pour bien s’en rendre compte ; ce numéro vous en propose deux :
Nous vous en souhaitons une excellente lecture. |
|
Sommaire |
|
Notre sélection de la semaineQuestions émissions |
|
Notre sélection de la semaine |
|
Comment accompagner la fin des avantages fiscaux sur les carburants pour les professionnelsProjet porté par Bruno Le Maire Lors des Assises des finances publiques, organisées en juin dernier à Bercy, le gouvernement a fixé à 2030 la disparition des principaux tarifs réduits d’accises sur le carburant. Les secteurs visés (BTP, transport routier, agriculture) seront « accompagnés ».1 Les carburants en France sont soumis à la taxe sur l’importation et la consommation de produits énergétiques (TICPE), qui varie selon les acteurs et les types de carburants, afin d’aider les professionnels des secteurs associés. C’est notamment le cas pour les acteurs du transport routier de marchandises (TRM), qui bénéficient d’un TICPE réduit de 25%, et pour les secteurs utilisant du gazole non routier (GNR), agriculture et construction en tête, dont la TICPE est réduite d’environ deux tiers pour un coût final du carburant réduit de moitié. Prévue entre 2024 (pour le GNR) et 2030 (pour le TRM), la disparition de ces avantages aura un impact variable suivant les secteurs concernés. Dans l’agriculture, la disparition d’un avantage qui nécessitera un mécanisme compensatoire de substitutionL’abandon de l’avantage fiscal GNR pour l’agriculture représentera une perte sèche pour le secteur. En effet, les 1,4Md€2 que représente cet avantage, soit environ 3500€ par exploitation, sont à mettre en regard d’un revenu de l’ordre de 25K€ par exploitation3. Pour un secteur “dopé” aux subventions de la PAC (50md€ sur 4 ans4,) et largement dépendant des énergies fossiles, c’est donc une substitution par une autre aide qui se profile. Reste à définir laquelle. À l’heure où le CESE5 a remis son rapport au ministre Marc Fesneau pour une agriculture plus sobre en énergies fossiles, plus locale, moins dépendantes d’intrants et moins productrice de protéines animales, en un mot “déglobalisée et décarbonée”, il faudra suivre de près l’établissement de la « Stratégie nationale alimentation, nutrition, santé » et la Loi Egalim 3 pour voir si l’arbitrage budgétaire aura un impact financier global sur le système agricole, ou si l’aide au GNR sera remplacée par une autre, sans évolution réelle de ce système. Dans le même sens que le CESE, le Shift Project prône une agriculture plus locale et une réduction des productions animales6. Vers une hausse des coûts dans le BTP ?Le GNR constitue 22% de la consommation d’énergie du secteur de la construction7, la majeure partie (61%) en matière de gazole routier. À noter cependant que cette proportion diffère suivant le sous-secteur : de moins de 10% pour les activités de bâtiment (étanchéification, isolation, construction de petits bâtiments), elle est beaucoup plus élevée pour les travaux de terrassement (54%) et plus encore pour les gros ouvrages ou le génie civil (87%). L’impact de la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR accordé à la filière travaux publics, la plus consommatrice, est évaluée à plus de 500 millions d’euros par la FNTP8, soit 1,4% du chiffre d’affaires et 60% de la rentabilité nette du secteur. Le syndicat met en avant deux conséquences : une augmentation des coûts sur les contrats à venir pour les commanditaires (principalement publics) et une diminution des marges sur les contrats en cours (dont les coûts ne sont souvent pas révisables). À court terme, un mécanisme compensatoire pour les contrats engagés serait donc souhaitable afin de ne pas éroder les marges du secteur sans contrepartie. À long terme, si l’on suppose le taux de marge nette à 3%, la hausse des prix du GNR impliquerait une hausse des prix du secteur de l’ordre de 1,5%. De son côté, le Shift Project promeut une sobriété générale dans la construction neuve9 qui permettrait notamment de diminuer fortement le recours à du GNR. En effet, le PTEF préconise notamment :
Cette réduction des constructions, qui porte également sur l’entretien et la création de nouvelles routes et infrastructures, demande en parallèle une baisse de l’usage de l’automobile. Pour le transport de marchandises, une perte de compétitivité en perspectiveLes allègements fiscaux accordés au transport de marchandises représentent 1,25 Md€ de manque à gagner pour les finances publiques10. Dans ce secteur, la forte concurrence accentue les crispations autour des sujets fiscaux (cf. notamment le mouvement des bonnets rouges en 2015). L’article 130 de la loi « Climat et résilience » (2021) prévoit la suppression du gazole professionnel d’ici 203011. Le Sénat souligne plusieurs risques associés à cette mesure12 :
C’est pourquoi, d’après le Sénat, une politique incitative d’aide à la transition doit accompagner le secteur. Différentes mesures pourraient être envisagées : hausse des plafonds des bonus écologiques, intégration du transport combiné dans les CEE13, exonération de CNSE (équivalent de la TICPE pour l’électrique). Dans ses projections pour décarboner le fret14, le Shift Project prévoit une réduction de 25% de la demande de transport de marchandise ainsi qu’un report modal vers le fret ferroviaire et fluvial. Cependant, même en réalisant ces efforts, le transport routier reste dominant. C’est pourquoi l’accent est mis sur les efforts à faire sur l’efficacité énergétique des camions, par l’amélioration de leur remplissage et de leur consommation unitaire (kWh/km), ainsi que sur leur électrification. En conclusion, la décision du gouvernement de supprimer progressivement les tarifs réduits d’accises sur le carburant dans divers secteurs d’ici à 2030 représente un tournant significatif pour l’agriculture, le BTP et le transport routier de marchandises. Cette mesure vise à atténuer notre dépendance collective aux énergies fossiles, tout en mettant en relief la complexité des arbitrages auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit de transformer des secteurs vitaux pour notre économie, tels que l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics, et le transport routier de marchandises, sans pour autant les mettre en péril. La balance entre impératifs environnementaux et stabilité économique est délicate et montre d’autant plus la nécessité d’une stratégie de transition planifiée, accompagnée et soutenue. 1 www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/carburant-lexecutif-prepare-la-fin-des-avantages-fiscaux-de-trois-secteurs-1953661 2 Les taxes sur les produits énergétiques, FIPECO 3 Décarbonation de l’énergie utilisée en agriculture à l’horizon 2050, Ministère de l’agriculture, 2023 4 Acter l’urgence, engager les moyens, p. 109, Haut Conseil pour le Climat, juin 2023 (« lien ») 5 Avis adopté : les recommandations du CESE pour un Pacte agricole ambitieux, Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), juin 2023 6 Plan de transformation de l’économie française : Agriculture et Alimentation (document de travail), The Shift Project, 2020 7 Les produits pétroliers, principale énergie dans le secteur de la construction, Commissariat général au développement durable, 2017 8 Hausse du GNR: une addition à plus de 500 M€ !, Fédération nationale des travaux publics, 2018 9 Habiter dans une société bas carbone (Plan de Transformation de l’Économie Française), The Shift Project, 2021 10 Carburants : l’exécutif prépare la fin des avantages fiscaux de trois secteurs clés, Les Échos, juin 2023 (« lien ») 11 Loi du 22 août 2021 sur la lutte contre le dérèglement climatique 12 Transport de marchandises face aux enjeux environnementaux, rapport d’information du Sénat, mai 2021 13 Les alternatives au transport routier, Ademe, août 2017 14 Assurer le fret dans un monde fini, The Shift Project |
Questions émissions |
|
La réindustrialisation face au défi du stress hydriquePortée par Daniel Breuiller (sénateur du Val-de-Marne - Groupe Écologiste Solidarité et Territoires) Le sénateur Daniel Breuiller interroge le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sa question porte sur les moyens déployés par le gouvernement pour concilier sa volonté de réindustrialisation avec une gestion économe et durable des ressources naturelles, notamment des ressources en eau. Dans le contexte actuel de stress hydrique, Daniel Breuiller rappelle que les activités industrielles sont gourmandes en eau ; il attire l’attention du ministre sur le fait que les projets de réindustrialisation voulus par le gouvernement impliquent une consommation accrue de cette ressource. Il illustre son propos avec trois exemples :
Au-delà de la gestion d’urgence, l’impératif de mesures de fondSelon Daniel Breuiller, les pouvoirs publics ne doivent pas seulement gérer les situations d’urgence mais également prendre la responsabilité d’interventions structurelles. Pour les ressources en eau, il affirme que des solutions de réutilisation et de recyclage existent mais sont coûteuses. Il en conclut qu’elles doivent donc procéder d’une volonté politique, par exemple en conditionnant les aides financières publiques au déploiement par les industriels de ces solutions. Daniel Breuiller interpelle donc le ministre sur les conditions de la réindustrialisation et des allégements fiscaux octroyés sans aucune exigence en termes d’économie d’eau et de ressources naturelles. L’exemple de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de sa suppression programmée sur 4 ans montrerait, selon le sénateur, que le gouvernement ne favorise pas une réindustrialisation compatible avec le dérèglement climatique. Dans sa réponse, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires affirme que la réindustrialisation permet de retrouver des circuits courts et donc de diminuer notre empreinte carbone. En matière d’eau, le ministre argue, en s’appuyant sur les rapports du GIEC, que la ressource disponible diminuera à cause de l’augmentation des températures et d’une absorption accrue par la végétation. C’est pourquoi le levier doit être la sobriété, et ce, “quels que soient les usages”. Les recommandations du Shift Project, des défis multisectorielsLes travaux du Shift Project sur la décarbonation du secteur de l’industrie1 mettent l’accent sur deux nécessités : l’amélioration des processus de fabrication pour qu’ils consomment moins de ressources et la sobriété. Celle-ci est en effet un levier qui représenterait 20% de la décarbonation du secteur dans le scénario le plus optimiste. Il s’agit de réduire le volume de la production mais aussi de faire avec une moindre dépense énergétique, extractive et chimique (par exemple en réduisant considérablement les emballages plastiques). Pour répondre aux besoins et compenser une partie de la perte d’emploi liée à cette baisse de production, le plan de transformation de l’économie française (PTEF) du Shift Project préconise le développement de la filière de l’après première vie (APV). Elle concerne l’ensemble des acteurs du recyclage, de la réparation et du réemploi. Cependant, ces différentes mesures ne sont pas toujours bien réparties sur le territoire et peuvent entrer en concurrence. C’est pourquoi le Shift Project appelle à une “véritable politique industrielle” structurant la filière afin notamment :
La protection de la ressource en eau ne concerne pas seulement l’industrie. La réindustrialisation va en effet devoir composer avec les autres secteurs économiques ainsi qu’avec les spécificités territoriales et l’impact du changement climatique, comme le rappelle The Shift Project dans ses travaux sur la transformation des territoires2. Dans un contexte de stress hydrique croissant, les conflits d’usages sont amenés à se multiplier si une politique à la fois globale et locale n’est pas engagée. Ainsi, l’agriculture, secteur déjà gourmand en eau (5% des terres cultivées nécessitent une irrigation qui représente 45% de la consommation totale d’eau en France), risque fort de voir sa demande en eau croître en réponse à l’accentuation des épisodes de sécheresse.3 Les plans d’urbanisme et le secteur du tourisme sont aussi concernés puisqu’ils doivent intégrer la protection des zones humides qui représentent les plus grands réservoirs de carbone par unité de surface et abritent une biodiversité exceptionnelle. Des arbitrage en matière d’usages de l’eau entre l’industrie, l’agriculture, la consommation humaine et la production électrique sont donc à anticiper et renforcent la nécessité d’une stratégie d’ensemble telle que la propose le PTEF. 1 Décarboner l’industrie sans la saborder, The Shift Project 2 "Climat, crises: transformer nos territoires", The Shift Project 3 rapport final "Climat, crises: transformer nos territoires", p.123 |
|
La gazette du carbone résulte du travail des bénévoles de l'association The Shifters, essentiellement réalisé sur la base de l’expertise du Shift Project.
Son objectif est d'informer sur les opportunités que présente l'arsenal juridique français pour décarboner notre société. Pour réagir au contenu, demander des précisions, proposer des évolutions, contribuer à notre action vers les décideurs, une seule adresse : gazette@theshifters.org !
Vous pouvez également découvrir The Shift Project et devenir membre de l'association. |